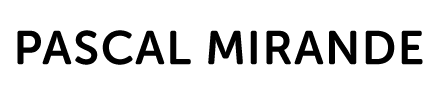Entretien avec Pascal MIRANDE
Patricia Limido et Nathalie Boulouch, Le 6 octobre 2015.
Colloque Les inventions photographique du paysage du XIXe siècle à nos jours
Université de Rennes, 30 septembre 2014
Pascal Mirande, en tant que photographe et plasticien, considérez-vous que la photographie est un moyen d’inventer le paysage ?
Je ne fais pas de différence entre la création d’une peinture, d’un jardin ou d’une photographie ; c’est toujours une démarche intellectuelle. La photographie, par sa nature même, définit un cadre contemplatif et donc décompose le paysage. Dans mon travail photographique je pense au jardin japonais traditionnel. Au Japon, celui qui construisait un jardin disposait des pierres pour que le promeneur se place au point de vue le plus intéressant. C’est exactement le principe de la photographie. On est témoin de quelque chose qui nous interpelle et on définit l’endroit du paysage en résonance avec ce que l’on veut mettre en lumière.
Peut-on dire que dans votre démarche créatrice, ce qui est premier, c’est d’abord une certaine image ou vision que vous cherchez à rendre visible, et pour cela vous fabriquez comme un point de vue, une scène, le plus souvent à partir de maquettes ou d’installations matérielles, en sorte que le point de vue est produit à partir de cette image, il est constitué autour d’un objet qui fait scène ?
Oui. Et au-delà, l’accident compte énormément dans mes images. C’est un peu comme dans le cinéma. Le réalisateur a une idée précise de ce qu’il veut filmer, mais tout à coup quelque chose intervient dans le plan, apparaît là où il ne l’attend pas, comme le passage d’un nuage ou une lumière inattendue. Dans la série Constellations, j’ai utilisé un temps de pose long de 30 secondes pour capter la lumière et créer un rapport au temps irréel pour que le lieu apparaisse de manière différente et se charge d’une lumière improbable.
Cette construction et le paysage tel que vous l’inventez doivent trouver un appui dans le regard de celui qui le regarde. Quel rôle laissez-vous à celui qui regarde par rapport cette invention du paysage ?
Il faut une connivence immédiate et ce jeu ne peut fonctionner qu’avec un lieu qui possède déjà une certaine complicité avec celui qui regarde. Elle vient tout simplement avec des sites très connus comme les falaises d’Etretat ou le Parthénon à l’Acropole. Mais j’utilise aussi des paysages liés à mes souvenirs d’enfance, comme le littoral de Charente Maritime. Ils ont une valeur affective mais leur singularité peut aussi évoquer autre chose. L’image en général, par sa construction, oblige le spectateur à regarder autrement. C’est toute la différence entre voir et regarder. La puissance de l’image réside dans sa capacité à figer un espace sur un fragment de temps pour le donner à contempler, non pas dans son entièreté mais bien dans sa singularité. La dimension réelle n’a aucune importance. Grâce au cadrage, on peut trouver du paysage dans n’importe quoi, faire du grand avec du petit ou du millénaire avec du périssable.
Vous partez d’un paysage réel mais en faisant intervenir des objets, des maquettes ou des simulacres, cela crée un dialogue entre le réel et la fiction.
C’est indispensable. C’est d’ailleurs un comportement d’enfant, qu’on ne doit pas perdre. En forêt par exemple, tout est différent si elle est empreinte du Petit chapeau rouge, du Petit poucet. Si on connaît les légendes arthuriennes, elle revêt un caractère qui va bien au-delà de l’humus, des bousiers ou des escargots ! C’est la dimension littéraire ou imaginaire qui donne une valeur aux lieux et aux choses.
Votre travail est toujours axé sur des icônes, des légendes, des objets mythiques mythologiques, des grands récits. C’est bien cela qui est fondamental dans votre démarche ?
Tout à fait. L’existence ou la véracité de certains grands mythes comme la conquête spatiale ou le monstre du Loch Ness provient toujours de la photographie comme une preuve. Et en retour, l’image conduit aussi toujours quelqu’un à tenter de prouver le contraire. Les traces des premiers pas sur la lune sont visibles au télescope et pourtant un mythe a été crée autour du fait personne n’y soit jamais allé. Avec la photographie, il est toujours question du vrai et du faux, dans les deux sens.
Le principe de votre travail semble le même que celui de Jean-Luc Godard lorsqu’il disait : « Si le cinéma sert à reproduire le réel, il ne sert à rien ». Diriez-vous que, pour vous aussi, si la photographie sert seulement à reproduire la réalité, elle ne sert à rien ?
La création artistique est comme l’amour : 1 + 1 = 3. Je ne cherche pas la perfection ou la reproduction du réel. C’est la part d’inattendu qui m’intéresse, à laquelle s’ajoute une part de moi-même. Cette alchimie permet de rebondir dans l’histoire ou lui donner du crédit. J’aime les allers et retours entre ce qu’on voit, ce qu’on perçoit, ce qu’on croit et les aléas. Je reste attaché à l’idée que la photographie est comme un tableau. Les falaises d’Étretat de Monet sont d’abord du Monet avant d’être Etretat. De la même manière je m’approprie les lieux, les histoires, les scènes.